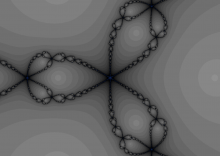La lampe du projo
Et voilà que maintenant, on nous parlait d'orientation à chaque cours ou presque, une sorte de mantra, avec par ailleurs nos profs nous noyant dessous des monceaux de papiers censés nous aider dans nos recherches, nos choix, les métiers qu'on visait, les études qu'on allait devoir suivre pour arriver là-bas, dans le monde adulte, bardés de tous les diplômes possibles, heureux, et riches nécessairement. De belles brochures très colorées. Des trucs Onisep qu'on feuilletait comme les catalogues de la Redoute, l'émotion et le rouge aux joues en moins puisque, tout le monde sait ça, c'est entre les pages de ce pavé arrivant par la poste puis traînant dans toutes les maisons qu'on a vu nos premières femmes presque dévêtues, dentelles et fanfreluches nous séparant à peine de leurs chairs qu'on imaginait lascives.
En attendant, pour notre avenir, on ne savait pas. On voulait tous être pompiers, ou aviateurs, ou ne rien faire, ça semblait bien aussi, on se disait, ça nous irait parfaitement, passer une vie entière à dormir sous les arbres, comme ambition, on s'en contenterait à défaut de satisfaire les espoirs que nos parents mettaient en nous. Cela pesait. Ils savaient bien qu'on pouvait passer une marche, sortir de notre monde d'ouvriers ou de paysans, de petites gens, ils sentaient ça, que ça pouvait être le moment, prendre l'ascenseur, devenir plus, un peu plus haut. Nous, on sentait cela aussi, et puis surtout l'attente dont on devenait porteurs, comme si on nous avait posé sur les épaules un costume qui n'était pas le nôtre, n'était pas à la bonne taille, nous laissait bras, mains, engoncés dans des manches flottants tels des étendards pathétiques. En bref, nous mettait les pétoches. Parce que mine de rien, ça pesait lourd, cette histoire d'ascenseur, de revanche sur la vie, ces rêves qui n'étaient pas les nôtres, sentaient souvent la vengeance du père, celle de la mère, remise en jeu une génération après qu'ils se soient pour leur part fracassés contre le mur d'un héritage qu'ils n'avaient pas, et je ne parle pas d'argent.